Faut-il bannir les cultures consommatrices d’eau ? Réponses d’experts

Le phénomène de pénurie d’eau que vit le Maroc a généré un discours qui pointe du doigt des cultures agricoles dites « très consommatrices d’eau ». Les exemples régulièrement cités concernent les tomates du Souss et de Dakhla, l’avocat du Nord ou la pastèque de Zagora. Nous avons demandé à plusieurs experts de nous dire ce qu'il en était réellement. Décryptage.
« Entendre que le Maroc exporte son eau alors qu’il n’en a pas est une aberration scientifique qui n’a pas le moindre fondement », nous annonce d’emblée Srhir Baali, agro-économiste et président de l’Association eau et énergie pour tous. « C’est un discours démagogue, populiste », nous lance un grand producteur agricole. Un exportateur de fruits et légumes nous parle de « contre-vérités qui sont véhiculées pour choquer » et fondées sur « de la propagande »…
Voilà comment nos sources du secteur, n’ayant un intérêt ni dans la tomate ni dans les agrumes, encore moins dans la pastèque ou l’avocat, réagissent à ce débat sur la pertinence du maintien de ces cultures consommatrices d’eau. Et développent leurs arguments pour montrer que « ce sujet ne devrait même pas être posé ».
À Zagora, le palmier consomme deux fois plus d’eau que la pastèque !
Prenons le cas de la pastèque de Zagora, le plus souvent signalé pour illustrer « les aberrations » de la politique agricole du pays.
Actif depuis 2006 via l’Association eau et énergie pour tous, l’agro-économiste Srhir Baali était présent lors de la conférence organisée sur le sujet, il y a quelques jours, au sein de la Commission des infrastructures, de l’énergie, des mines et de l’environnement à la Chambre des représentants. Une conférence où étaient présents le ministre de l’Eau, le patron de l’ONEE, le CESE, des experts du domaine ainsi que des représentants de la société civile.
« Les députés ont soulevé ce problème de la pastèque de Zagora en répétant le discours que l’on sait tous sur l’aberration de planter des fruits qui consomment beaucoup d’eau dans une région désertique. Je me suis mis à contre-courant en donnant des exemples concrets qui balaient ce discours, et en appelant même à préserver cette pastèque que je considère comme un produit du terroir de Zagora », nous explique l’agro-économiste.
Parmi les exemples évoqués par notre source figure celui du palmier, autre culture très répandue à Zagora et dans la région.
Si l’on suit le raisonnement de ceux qui veulent stopper la culture de la pastèque, c’est plutôt le palmier qu’il faut arracher à Zagora…
« Un des arguments que j’ai avancés est celui de la consommation d’eau de la pastèque par rapport au palmier. Un hectare de pastèque consomme entre 5.000 et 6.000 m3 d’eau au maximum. Alors que le palmier consomme 12.000 m3 à l’hectare. Et entre les pieds du palmier, comme tout le monde le sait, on cultive la luzerne. La luzerne, au niveau d’Ouarzazate et Errachidia, consomme entre 18.000 et 22.000 m3 l’hectare. Si l’on suit le raisonnement de ceux qui veulent stopper la culture de la pastèque, c’est plutôt le palmier qu’il faut arracher dans la région… », nous lance Srhir Baali.
Pour lui, la pastèque ne pose aucun problème. Tout est dans le dosage, précise-t-il.
« Par rapport au microclimat de Zagora, la pastèque est une culture qui peut être considérée comme un produit de terroir, qu’il faut préserver. Parce que les conditions pédoclimatiques lui confèrent une qualité supérieure à celle de n’importe quelle zone au Maroc. C’est un produit de terroir qui s’exporte en Italie, en France, en Allemagne… et sur lequel il faudrait encore travailler. Il faudrait toutefois veiller à ce qu’il n’y ait pas d’autres variétés qui entrent sur le territoire pour préserver le label Zagora », indique l’agro-économiste.
Le choix de faire de la pastèque à Zagora n’est pas donc fortuit, si l’on en croit les chiffres et les données avancés par notre agro-économiste. Le climat de la région s’y prête, et cette culture a permis aux populations locales d’améliorer sensiblement leurs revenus. Et de créer une sorte de produit de terroir d’une qualité inégalée qui s’exporte un peu partout dans le monde. Mais le président de l’Association eau et énergie pour tous pense toutefois que cette culture a besoin de plus de contrôle, de régulation.
« Dans cette région, il y a toujours eu de l’eau et il y en aura toujours. L’eau est présente là-bas depuis des siècles. Maintenant, il faut savoir la gérer. C’est une question de gouvernance, de gestion. Je pense qu’à moins de 3.000 hectares de pastèques, le problème ne se pose pas. Mais il se trouve que l’on a dépassé cette superficie tolérable pour les ressources en eau. On a atteint 6.000 ha certaines années ! Il faut donc préserver la pastèque, mais aussi veiller à l’équilibre et ne pas augmenter les superficies actuelles. Et si augmentation de superficie il y a, elle doit prendre en considération le renouvellement de nos nappes phréatiques. Tout est question de dosage… », Nuance notre interlocuteur. Il propose un système de régulation à travers une autorisation délivrée par les pouvoirs publics, sur la base d’une approche territoriale de la politique agricole, mais aussi via la subvention distribuée par le département de l’Agriculture.
Deux leviers, nous explique-t-il, qui peuvent permettre de réguler la production, san
s entraver le principe acté en 1994 de la liberté de produire.
« Il fallait adapter la territorialisation et plafonner la superficie des pastèques »
« Lorsqu’on a commencé à cultiver des pastèques à Zagora, tout le monde voulait en faire parce qu’il y avait un grand élan à l’export. Sauf que si l’on avait adopté la territorialisation dans notre politique agricole qui est basée aujourd’hui sur l’approche filière, on aurait assuré pour la population locale une superficie de 2.000 à 3.000 ha et, à partir de 3.000 ha, on n’autoriserait plus les opérations de pompage d’eau pour les pastèques. Ce qui aurait pu éviter ce phénomène que l’on voit d’investisseurs étrangers qui viennent à Zagora, inconnus des bases de données du département, qui louent des terrains sur place, pompent à outrance, irriguent gravitairement et aggravent la situation de la nappe. Et une fois la ressource épuisée, ils partent ailleurs », nous explique Srhir Baali. Si ce dernier ne s’oppose pas à la liberté de choix de l’agriculteur, il milite pour un système de régulation pas seulement à Zagora, mais dans toutes les régions du Maroc et pour toutes les cultures, y compris pour les céréale.
L’association qu’il préside, membre du conseil d’administration de l’association mondiale ‘Droit à l’énergie SOS future’, qui siège au niveau du Conseil économique et social des Nations unies, plaide pour une modélisation de la gestion de la nappe phréatique. Il s’agit d’assurer l’adéquation entre les superficies existantes et les ressources en eau disponibles pour permettre une régénération de la nappe.
« L’avocat, ce n’est pas un sujet… »
A l’instar de la pastèque, les cas de la tomate et de l’avocat sont également des « clichés » selon nos sources.« L’avocat, ce n’est pas un sujet », nous dit un professionnel du secteur. « On fait au maximum 50.000 tonnes dans un marché qui se compte en millions de tonnes. On a fait 30.000 tonnes l’année dernière. Et l’avocat se cultive dans des zones humides où il n’y a pas de problème d’eau, notamment à Moulay Bousselham et dans le nord du pays. Les superficies sont très limitées et la production est très faible », précise-t-il.
Le président de l’Association eau et énergie pour tous ne dit pas autre chose. L’avocat fait partie de ce qu’il appelle « les nouvelles dynamiques de production ». Une niche qui, selon lui, ne pose pas problème.
« Quelle que soit la volonté manifestée, l’avocat ou les autres cultures qui s’inscrivent dans les nouvelles dynamiques de production resteront toujours limitées, que ce soit en termes de superficie ou de production. Tout ce que l’on peut faire, c’est optimiser les programmes d’irrigation qui doivent être très respectueux des démarches scientifiques pour permettre une économie importante de l’eau. Avoir quelques superficies dédiées à l’avocat, ce n’est pas cela qui va épuiser la nappe phréatique. Avancer le contraire est complètement aberrant d’un point de vue scientifique », estime Srhir Baali.
Pour nos sources, le débat sur ces cultures consommatrices d’eau est biaisé. D’abord pour une question de valorisation : un hectare d’avocat est mieux valorisé qu’un hectare de céréales. Et il est donc logique, nous confie notre producteur agricole, d’exporter là où l’on a un marché ; c’est le cas de l’avocat qui s’exporte un peu partout en Europe, ou celui de la tomate dont le Maroc est un des plus grands exportateurs mondiaux. Cela permet d’avoir des recettes en devises, et d’utiliser une partie de ces devises pour importer des céréales qui sont produites beaucoup moins cher que les nôtres.
« En raisonnement macroéconomique, les choses sont évidentes. A part cet accident de guerre en Ukraine, il n’y a même pas débat là-dessus. Le blé marocain revient plus cher que le blé que nous importons. Il serait illogique d’abandonner des cultures où nous avons des gains importants pour faire des céréales plus chères que celles que nous pouvons acheter sur d’autres marchés », explique notre producteur.
Autre argument avancé : la consommation d’eau en elle-même, qui doit être relativisée.
« Pour produire 250 grammes de pommes de terre, il faut 40 litres d’eau. Ça ne veut pas dire que la plante qui permet de produire les 250 grammes aspire totalement les 40 litres, il y a une partie ruisselée, évaporée, une partie extraite par les mauvaises herbes, et puis une partie de la plante qui va être enfouie et revenir à la nappe sous forme de résidus ou de matières organiques », explique l’agro-économiste Srhir Baali.
Un professionnel du secteur cite l’exemple des agrumes, réputés également être consommateurs d’eau. « Quand on irrigue un hectare d’agrumes, on va utiliser 10.000 m3 pour en sortir 40 tonnes l’hectare. Ça fait 250 litres d’eau par kilo. Mais cette eau ne part pas dans le fruit. Elle est utilisée et redescend dans la nappe, parce que la consommation de l’arbre est beaucoup plus faible que ça. En réalité, quand on exporte un kilo d’orange, on exporte 950 grammes d’eau et pas 250 litres. »
Idem pour la tomate, que beaucoup considèrent comme un gâchis en matière d’eau, allant jusqu’à dire qu’en faisant de la tomate, le Maroc exporte son eau… Une phrase devenue presque une vérité tellement elle a été martelée !
Le kilo de viande consomme 125 fois plus d’eau que le kilo de tomate !
« On exporte de l’eau quel que soit le produit. Mais ce n’est pas le volume à l’hectare qui est exporté. Si vous écrasez vos tomates et vous les séchez, vous avez de la matière sèche, et environ 70% du poids qui est fait d’eau. On importe aussi de l’eau. Quand vous avez de la conserve importée d’Europe, c’est aussi de l’eau qu’ils ont exportée. Il faut faire une sorte de balance de l’eau (en référence à la balance commerciale, ndlr). Quand vous achetez des pulls en coton importés, c’est de l’eau que vous achetez également. La culture du coton au Sri Lanka et en Malaisie se fait avec de l’irrigation gravitaire, et ça consomme beaucoup d’eau. Quand vous achetez une voiture, c’est une quantité d’eau qui est importée aussi parce que les minerais sont traités par l’eau. In fine, si on fait le calcul, on doit donc être largement excédentaire dans cette balance import-export de l’eau », souligne notre expert.
Et puis la tomate, contrairement à ce que l’on imagine, ne consomme pas tant d’eau que cela.
« Pour chaque kilo de tomate, c’est 100 à 120 litres d’eau qui sont requis. Ça dépend aussi du mode de production, sous serre, ou sous champ… Les 100 à 120 litres sont juste un ordre de grandeur. La réalité dépend de la nature du sol. Si vous êtes face à un sol lourd, constitué à grande majorité d’argile, la capacité de rétention d’eau du sol argileux n’est pas la même que celle d’un sol sablonneux ou limoneux. Puis il y a des sols composites où il y a de l’argile, du limon, du sable… », Rappelle Srhir Baali.
Et si l’on compare la consommation en eau de la tomate à d’autres produits agricoles, on se rend compte que la tomate n’est pas la pire des cultures.
Exemple de la pomme de terre dont on ne parle jamais. Si 250 grammes de pommes de terre nécessitent 40 litres d’eau, comme cité plus haut, le kilo consomme donc 160 litres… Davantage que la tomate qui est objet de polémique.
Autre exemple plus parlant, celui de la viande. « La viande exige 15.000 litres d’eau par kilo, pour donner l’aliment nécessaire à la vache avant qu’elle ne grossisse et qu’on puisse l’abattre et récupérer la viande. La consommation d’eau est énorme. Faut-il arrêter la production de viandes rouges ? », s’interroge un autre producteur, sondé par Médias24.
Pour l’ensemble de nos sources, retenir le seul critère de la consommation d’eau dans l’absolu pour juger de la viabilité d’une culture n’est pas une démarche honnête intellectuellement. Car les choses s’avèrent beaucoup plus nuancées et complexes.
Au-delà de sa consommation en eau, la tomate, par exemple, joue un rôle extrêmement important dans l’économie marocaine. Un rôle multiple, selon un professionnel du secteur.
« Le critère qu’il faut toujours avoir en tête est la valorisation de l’eu utilisée. Un hectare d’agrumes rapporte de 30.000 à 50.000 dirhams par exemple en devises. En tomates, c’est beaucoup plus. Cette eau n’est donc pas gaspillée. Il faut voir aussi l’impact social. On a lancé une vendetta contre ce qu’on appelle les cols blancs, mais sans ce travail d’export, sans ces investisseurs qui s’endettent et prennent des risques, on n’aurait pas cet export. Et cet export a trois rôles : un rôle économique, un rôle social et un rôle de stabilité des prix sur le marché local », explique notre professionnel.
Péréquation : l’export permet de vendre moins cher sur le marché intérieur
« Pour la tomate, dans la moyenne de l’année, on exporte 70% de la production marocaine. 30% restent sur le marché local. Les 70% sont vendus trois à quatre fois le prix du marché local, départ station. En fait, si on n’avait pas l’export, il faudrait vendre la tomate au Maroc deux à trois fois son prix actuel. La hausse des prix qu’on a eue durant quelques semaines cette année, on l’aurait eue chaque année. C’est la valeur créée par la partie export qui fait qu’on est capable d’approvisionner le marché local à des prix corrects. Et cela concerne tous les fruits et légumes. C’est une péréquation qui se fait », indique notre source.
Et ce, sans parler du rôle social des cultures de fruits et légumes, « qui emploient rien que dans le bassin d’Agadir et hors agrumes, entre 150.000 et 200.000 personnes ». « Je parle de personnes, donc de 150.000 à 200.000 familles, soit plus d’un million de personnes qui vivent de manière directe de la tomate », rappelle notre interlocuteur.
Cette culture, ce sont aussi des investissements à l’œuvre, ajoute un autre professionnel du secteur agricole. « Il ne faut pas oublier que sur la tomate, ce sont des investissements énormes qui ont été réalisés, que ce soit dans la région d’Agadir ou de Dakhla. Ce sont des actifs, des bassins d’emploi qui créent de la valeur pour l’économie. A Agadir, il y aujourd’hui la station de dessalement d’eau qui s’est faite justement pour sauvegarder les emplois et les investissements sur place, ainsi que le capital marché et marque que nous avons à l’international. Est-ce qu’on va renoncer à tout ce capital ? La tomate se vend à 4 euros aujourd’hui en Europe. Et l’alimentaire est un secteur d’avenir. Si nous avons un problème d’eau, la solution n’est pas de réduire les superficies, mais de trouver des solutions, car aujourd’hui, nous avons des positions, des parts de marché importantes en Angleterre, aux Pays-Bas, en France et dans les pays de l’Est que l’on ne peut pas abandonner. Ce serait une pure folie économiqe… »
L’autre élément signalé par nos sources concerne le changement de la structure même de la production de tomates dans le pays. Car contrairement à ce que l’on pense, ce n’est pas la tomate ronde qui s’exporte le plus, mais la tomate de segmentation (la tomate cerise, la tomate allongée, la grappe…), un produit mieux valorisé que la tomate classique.
« Il y a dix ans, la tomate de segmentation ne représentait même pas 20% des exportations marocaines de tomates. Aujourd’hui, elle représente plus de la moitié. Notre production est donc mieux valorisée. La tomate ronde coûte certes moins cher à produire, mais elle se vend aussi moins cher. La tomate cerise coûte en revanche plus cher à produire, mais se vend également plus cher. Ce n’est pas nécessairement plus rentable, mais en termes d’apport en devises, la différence est énorme. Pour un kilo d’eau, la tomate cerise rapporte trois fois plus de devises que la tomate ronde », précise notre producteur.
De la tomate au Sahara, une aberration ?
Reste la question que tous les Marocains ou presque se posent : pourquoi cultive-t-on de la tomate au Sahara, notamment à Dakhla ? La question paraît à première vue parfaitement logique : le Sahara, c’est le désert. Et pourtant on y cultive un produit qui nécessite de l’eau. Un non-sens ? « Pas du tout », rétorquent nos experts.
« Au niveau du Sahara, il y a un microclimat qui permet une productivité très élevée. A Dakhla, nous avons aussi une des plus grandes nappes phréatiques du pays. Et si on n’exploite pas cette eau, il y a des opérateurs en Mauritanie qui pompent de l’autre côté pour alimenter leurs exploitations minières très consommatrices en eau. A Dakhla, on est toujours sur le renouvelable et le gérable. Et sur des superficies encore petites qui ne dépassent pas les 5.000 hectares. Donc le problème ne se pose pas », explique Srhir Baali, balayant au passage un autre cliché qui a la vie dure.
Notre agro-économiste se veut même optimiste pour cette culture à Dakhla, notamment avec le projet de station de dessalement d’eau de mer destiné à irriguer les exploitations agricoles de la région. Une station qui permettra non seulement de préserver la nappe phréatique, mais aussi de rendre encore plus compétitive la tomate made in Dakhla.
« La station de dessalement, qui va desservir les 5.000 ha de tomates, va assurer une longévité optimale de la ressource. Et le coût de l’eau issue de la station sera très bas, entre 2 et 3 dirhams le m3 au maximum. L’eau de la station de Chtouka à Agadir coûte 5 à 6 dirhams le m3. Et à ce prix, Agadir reste très compétitive, sachant qu’il y a près de vingt ans, on atteignait 10 dirhams le m3 par le pompage thermique au gasoil. Le dessalement nous permet de faire des économies contrairement à ce que l’on pense. Et à Dakhla, les gains de compétitivité seront encore plus importants parce que cette station fonctionnera à l’énergie éolienne. Si l’énergie renouvelable est utilisée dans nos futures stations de dessalement, cela va permettre à notre agriculture d’être encore plus compétitive par rapport à des pays comme l’Espagne, la Tunisie ou l’Egypte…», explique notre agroéconomiste.
Pour nuancer son propos, Srhir Baali soutient qu’il ne faut être ni alarmiste ni négligeant. Il s’agit de toujours avoir en tête la gestion et l’optimisation de la ressource, même si celle-ci est disponible. Et cela ne peut se faire qu’à travers des mécanismes de régulation. Une régulation qui reste, d’après lui, un des points faibles du Plan Maroc vert, et dont l’absence est à l’origine de tous ces débats non argumentés sur la consommation d’eau.
Réguler sans enfreindre la règle du marché libre de production
« Si l’on veut être honnête intellectuellement, le Plan Maroc vert a beaucoup apporté au Maroc, il faut le reconnaître. Il a été établi selon l’approche filière, c’est-à-dire que, du champ jusqu’à la fourchette, on fait valoir les gains de valeur ajoutée au niveau de chaque segment de la chaîne. Cette approche, bien qu’elle ait apporté beaucoup de choses pour le pays, a créé quelques dommages collatéraux liés au fait que soit on a omis, soit on n’a pas considéré que c’était nécessaire – je parle de volonté politique – de prendre en compte l’aspect territorial. C’est ce qui fait que nous avons aujourd’hui tous ces débats qui ne sont pas suffisamment argumentés, et que tout le monde peut parler de n’importe quoi », considère le président de l’Association eau et énergie pour tous.
Cette approche territoriale défendue par notre agro-économiste consiste en deux volets : définir la vocation agricole de chaque territoire ou région et instaurer un système d’autorisation pour les cultures qui ne s’inscrivent pas dans ces vocations, en régulant le tout par la subvention étatique.
« Le fait de produire n’importe où, n’importe quoi, et de subventionner de la même manière, de Tanger à Lagouira, tous les producteurs ne permet pas d’optimiser les ressources en eau ni les ressources financières injectées par l’Etat. Et cela permet à quelqu’un de l’Oriental par exemple, qui ne peut jamais être productif en comparaison avec la région d’Agadir ou de Meknès, du Gharb ou du Saïs, de faire la même production et d’être subventionné de la même manière », détaille Srhir Baali.
Il cite l’exemple des céréales dans l’Oriental qui se sont avérées un véritable gâchis.
« Si on avait intégré l’approche territoriale, on n’aurait pas eu la possibilité de défricher des terrains qui sont purement pastoraux, comme dans l’Oriental par exemple, où l’on a fait des céréales qui ont été productives les trois premières années, mais ont perdu en productivité après, pour la simple raison que ce sont des terrains à vocation pastorale. En faisant ça, on n’a pas pu être productifs sur les céréales, et on a perdu malheureusement les semences des plantes pastorales qui étaient là depuis des siècles. Aujourd’hui, si on veut revenir en arrière et replanter ce territoire en plantes pastorales, il faut aller en Australie pour acheter la semence qui était chez nous », illustre notre expert.
L’approche que défend Srhir Baali est la suivante : la Chaouia, par exemple, est le grenier du Maroc en céréales. C’est donc une région qui a une vocation agricole bien précise. Celui qui veut faire des céréales dans la région est le bienvenu. Il bénéficiera du soutien de l’Etat et de tous les mécanismes d’aide en place. Mais s’il veut faire une autre culture, ce qui est son droit, c’est à lui d’assumer la responsabilité de son projet. Ce raisonnement peut s’appliquer également à des zones à vocation laitière ou agrumicole. Une sorte d’orientation de la production par la subvention…
« La subvention se fait aujourd’hui en amont et est donnée à tout le monde, de la même manière. Elle est perçue par celui qui est productif et celui qui ne l’est pas. Or, la subvention, hormis celle du matériel agricole, doit se faire en amont sur l’output, selon des critères de productivité bien définis. Quand je vous donne 1 dirham de subvention, j’attends en principe 2 dirhams de production, voire 3 dirhams. Mais quand vous n’êtes pas productif et que vous recevez la subvention, c’est de l’argent qui n’est pas suffisamment optimisé, voire gaspillé. Et vous aurez ainsi des producteurs actifs sur des territoires qui ne sont pas adaptés à certains systèmes de production. Et on subventionne sans le savoir la dégradation des ressources », explique Srhir Baali.
C’est le cas des céréales, avec une subvention ‘aveugle’ qui ne distingue pas les producteurs.
« Dans la Chaouia par exemple, il y des producteurs qui font 40 quintaux l’hectare (q/ha). Mais il y a des gens qui font 90, voire 100 q/ha dans la même région, au niveau de Zhiliga et du côté de Zaër. En termes de productivité, nous avons des producteurs dans cette région qui n’ont pas à rougir des meilleurs producteurs français. Le potentiel est là. Il y a un savoir-faire, un paquet technologique qu’il faudrait généraliser, en fonction de la vocation. Dans la Chaouia, la vocation est céréalière, mais la subvention qui doit être donnée aux agriculteurs doit être donnée au niveau de l’output et pas de l’input. On classe les producteurs en trois catégories, les meilleurs, les moyens et les faibles. Et via la subvention de l’output, on va encourager les faibles à aller vers les moyens, en les poussant à faire des progrès pour augmenter leur productivité. »
« C’est un exemple parmi d’autres, on peut l’extrapoler à d’autres cultures, d’autres vocations. Et lorsque je suis sur un territoire où je fais une culture qui ne correspond pas à la vocation du territoire, j’assume ma responsabilité, je ne serai pas subventionné par l’Etat et je ne serai pas compétitif. C’est comme ça que l’on peut réguler les choses par la subvention. C’est très simple. On préserve le droit de production, parce que c’est un droit, et on régule la production par la subvention. Une subvention qui doit être ciblée pour encourager la productivité par le jeu de la concurrence. Avec cette approche territoriale, nous aurions eu des outils d’orientation et de régulation de la production pour pouvoir préserver la ressource là où elle est insuffisante, et faire ainsi des systèmes de production adaptés au territoire et qui sont plus productifs », explique le président de l’Association eau et énergie pour tous, qui précise que seuls les grands producteurs doivent obéir à ce système, et que la subvention doit rester telle quelle pour le petit fellah.
Le 19 avril 2022
Source web par : medias24
Les tags en relation
Les articles en relation

Le Maroc perdrait 80% de ses ressources hydriques dans 25 ans
La sécurité hydrique du royaume est menacée. C’est le constat alarmant livré par le Conseil économique, social et environnemental (CESE), qui explique qu...

Al Hoceima/ Nador : L'Espagne accorde au Maroc un prêt de 12 millions d'euros pour réaliser une us
Le gouvernement espagnol, réuni vendredi en Conseil des ministres, a approuvé un accord portant sur l’octroi au Maroc d’un prêt de 12 177 323 d’euros p...

Modèle de développement: Les propositions du CESE
Le Conseil économique, social et environnemental (CESE) vient de partager sa contribution pour le nouveau modèle de développement. Le document, d’une centa...

L’associatif touristique cherche Présidents !
Si les prochaines élections nationales sont très importantes pour le Maroc des années à venir. A l’image des élections prévues, une pensée pour celles ...

Au Maroc, le manque d’eau désespère les villages
Le royaume chérifien subit une grave sécheresse depuis plus de quarante ans. Dans les années 1960, la disponibilité en eau était quatre fois supérieure à...

Energie renouvelable : l'ONEE rencontre une délégation britannique pour le projet Xlinks
Abderrahim El Hafidi, Directeur Général de l’ONEE a reçu, à Rabat, une délégation du Ministère Britannique de la Sécurité Énergétique et du Net Zé...

Sahara marocain: des chefs d'entreprises françaises prospectent les opportunités d’investissemen
Des chefs d’entreprises françaises ont tenu à Dakhla hier, mardi 26 octobre 2021, une rencontre avec des responsables locaux, en vue d’explorer les opport...

Réchauffement climatique : Préoccupations du CESE sur l’état des ressources naturelles
Le Conseil économique, social et environnemental (CESE) a tenu, le 31 août 2023, la 149ème session ordinaire de son assemblée générale, laquelle s'est...

Maroc : Le Conseil supérieur de l'eau et du climat ressuscité après 16 ans d'inactivité ?
Après 16 années d'inactivité, le Conseil supérieur de l'eau et du climat (CSEC) enfin ressuscité ? En mettant en place une commission ministériell...

Pour un meilleur accès à l’eau et aux services d’assainissement dans le continent
Pour l’heure, le Maroc est, selon le directeur de l’ONEE, engagé dans un programme d’assainissement étalé sur 2017-2020 pour atteindre 140 stations de ...

Protection sociale au Maroc : C’est là que le bât blesse le plus
Le Conseil social, économique et environnemental n’y est pas allé par quatre chemins. L’avis sur la protection sociale au Maroc que son assemblée génér...

Quel Maroc de l’après-séisme ?
Dans le déroulé de la vie sociale des deux décennies écoulées figurent en bonne place de fortes séquences : les séismes d'Al Hoceima du 24 février 2...
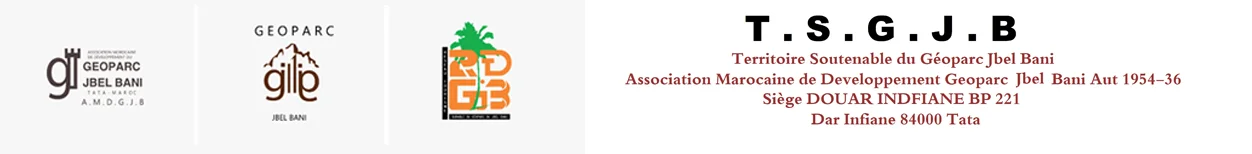

 mercredi 20 avril 2022
mercredi 20 avril 2022 0
0 







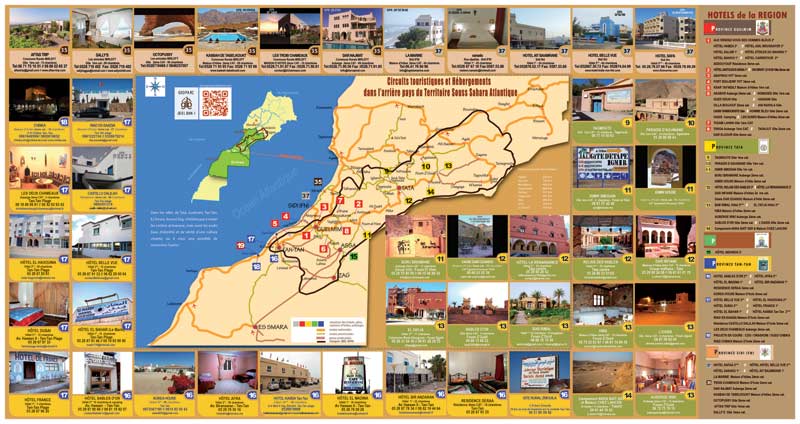



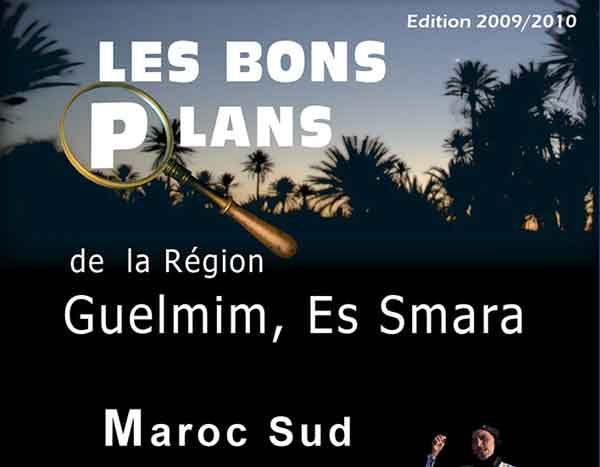



















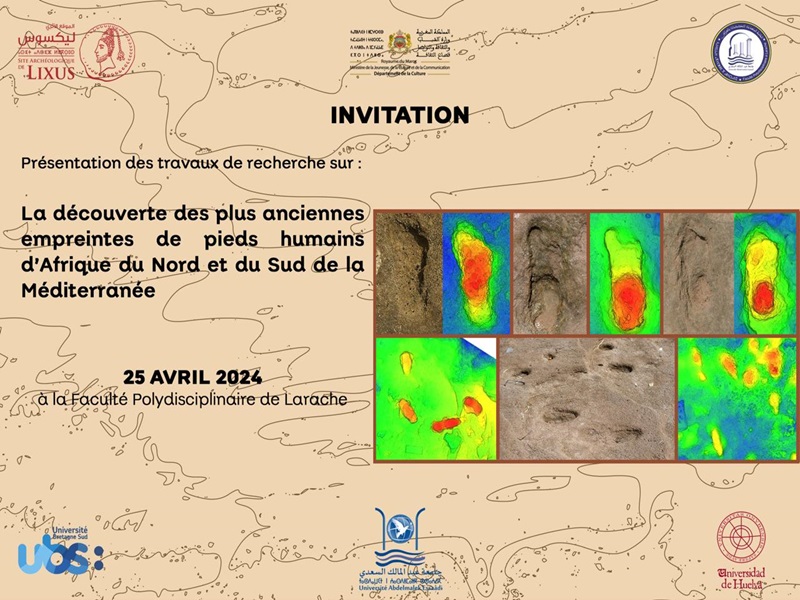










 Découvrir notre région
Découvrir notre région